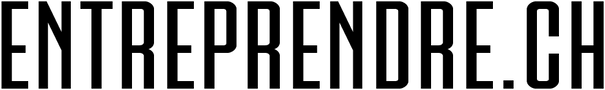Les différents types d'apport en capital : l'apport en nature
- Comprendre l’apport en nature et son fonctionnement en Suisse
- Les avantages et les contraintes d’un apport en nature pour une entreprise
- Les exigences légales et techniques pour un apport en nature
- Différences entre une SARL et une SA en matière d’apport en nature
- Les étapes pour réaliser un apport en nature avec succès
Lorsqu’un entrepreneur suisse envisage de fonder une SARL ou une SA, se pose rapidement la question de la constitution du capital social ou du capital-actions.
Dans un monde idéal, les fondateurs disposent de liquidités suffisantes pour alimenter ces fonds. Pourtant, la réalité économique est plus nuancée : il est fréquent de posséder déjà du matériel, des machines, des brevets, voire même un bien immobilier pouvant jouer un rôle essentiel dans le projet.
Le recours à un apport en nature devient alors une solution opportune, puisque cela permet de valoriser des actifs non monétaires au moment de la création de la société.
L’apport en nature soulève néanmoins des questions : quels biens sont acceptés ? Comment en déterminer la valeur ? Quelles sont les formalités à remplir pour que tout soit validé légalement ? Quelles spécificités distinguent une SARL d’une SA dans ce contexte ? Et existe-t-il des inconvénients, voire des risques ?
Notre équipe Entreprendre.ch vous propose un tour d’horizon complet des apports en nature : définition, avantages et contraintes, vérifications par un réviseur agréé, conditions pour le transfert de propriété, aspects liés à l’immobilier, etc.
Les explications ci-dessous s’adressent aussi bien aux futurs fondateurs de sociétés qu’aux entrepreneurs aguerris souhaitant convertir une raison individuelle ou un ensemble d’actifs existants en capital social pour leur prochaine aventure. À la clé, vous trouverez des conseils pratiques et des exemples concrets pour vous guider pas à pas dans cette démarche.
Nous vous invitons également à consulter notre vidéo en lien avec le sujet afin de compléter votre compréhension.
Qu’est-ce qu’un apport en nature ?
Lors de la création d’une SARL ou d’une SA en Suisse, les fondateurs peuvent choisir d’apporter des actifs non monétaires au capital de leur entreprise. Cette alternative au versement en espèces permet d’intégrer des biens matériels ou immatériels directement dans le patrimoine de la société, sous réserve de respecter certaines conditions légales.
Définition et principes généraux
Un apport en nature est un bien autre que de l’argent (numéraire) qu’un associé ou actionnaire décide d’intégrer dans le patrimoine social au moment de la fondation (ou parfois lors d’une augmentation de capital ultérieure).
À la différence d’un versement bancaire (apport en espèces), l’apport en nature peut prendre diverses formes : matériel de bureau, machines industrielles, brevets, parts dans d’autres entreprises, créances, ou encore immeubles. En contrepartie, l’apporteur reçoit des parts sociales (dans une Sàrl) ou des actions (dans une SA), qui lui octroient droits de vote et éventuels dividendes.
La notion clé réside dans le fait que ce bien doit avoir une valeur économique objectivable et qu’il doit pouvoir être transféré à la société de manière claire et irrévocable. Dès la constitution, la société devient propriétaire de l’actif en question.
Cela lui évite de mobiliser de la trésorerie pour acquérir l’élément, tandis que l’apporteur voit son patrimoine en nature converti en capital social.
Quelques exemples concrets
- Un indépendant qui dispose d’une flotte de véhicules professionnels pour son activité de transport peut apporter ces véhicules en nature s’il décide de créer une SARL de logistique.
- Une start-up technologique souhaite breveter un logiciel développé en interne ; l’associé qui détient les droits sur ce logiciel peut l’apporter en nature à la société, valorisant ainsi l’actif immatériel.
- Un entrepreneur possédant un entrepôt ou un local commercial peut en faire un apport immobilier pour libérer tout ou partie du capital-actions dans une SA.
Dans chacun de ces scénarios, le bien intègre directement l’actif de la société, et le capital minimum légal (20’000.- CHF pour la Sàrl, 100’000.- CHF pour la SA) peut ainsi être constitué en tout ou partie par la valeur du bien.
Besoin de conseils pour mettre en place votre projet ?
Consultation personnalisés avec un expert : 30 minutes pour 89.- CHF
Les atouts et inconvénients d’un apport en nature
L’apport en nature est une solution avantageuse pour les entrepreneurs qui souhaitent limiter l’immobilisation de trésorerie et valoriser des actifs existants. Toutefois, cette option implique des contraintes réglementaires et des risques qu’il convient d’anticiper pour éviter tout déséquilibre financier ou juridique.
Avantages pour l’entrepreneur
- Moins de trésorerie immobilisée : en apportant un actif déjà en possession, le fondateur n’a pas besoin de mobiliser ou de débloquer immédiatement des liquidités.
- Valorisation optimale de ses biens : au lieu d’avoir à revendre un actif ou contracter un prêt, l’apport en nature convertit directement le bien en parts de la société.
- Attractivité vis-à-vis des créanciers et partenaires : l’actif figure dans le bilan de la société, potentiellement renforçant sa solidité, à condition que l’évaluation soit fiable.
- Optimisation fiscale (dans certains cas) : selon la nature du bien et le mode de transfert, le fondateur peut éviter certaines plus-values imposables ou coûts de cession (attention, il faudra toutefois analyser la situation au cas par cas pour vérifier l’absence de conséquences fiscales indésirables).
Risques et contraintes
- Formalités strictes : il ne suffit pas de déclarer la valeur. Il faut respecter un cadre légal précis, y compris un passage devant notaire (pour la constitution) et parfois un rapport de fondation spécifique.
- Évaluation obligatoire par un réviseur agréé : si la valeur est surestimée, cela peut engendrer de graves conséquences juridiques ou tromper les créanciers sur la solvabilité de la société. Si elle est sous-estimée, l’apporteur est lésé en termes de participation au capital.
- Transfert effectif de propriété : l’apporteur perd la maîtrise du bien qui devient propriété de l’entité morale. Par exemple, un immeuble apporté sera inscrit au nom de la société, et non plus à celui de l’entrepreneur.
- Incompatibilité de certains biens : certains actifs (services futurs, droits strictement personnels, licences à usage temporaire…) ne peuvent pas être apportés en nature, car ils ne répondent pas à la condition de disponibilité et de transférabilité immédiate.
Conditions légales et techniques pour l’apport en nature
En Suisse, les apports en nature doivent répondre à des critères précis. De plus, un réviseur agréé doit valider leur valeur avant leur intégration au capital social, garantissant ainsi la transparence et la sécurité de l’opération.
Disponibilité, transférabilité et évaluation
La loi suisse (Code des obligations, art. 628 pour la SA et art. 777 pour la Sàrl, complété par d’autres dispositions) insiste sur trois grands piliers :
- Le bien doit être disponible : l’entreprise doit pouvoir l’exploiter ou le liquider immédiatement si besoin (ce qui exclut les apports “promis” dans le futur).
- Le bien doit être transférable : l’apporteur doit prouver sa pleine propriété et garantir le bien contre l’éviction (par ex., pour un brevet, prouver qu’il n’y a pas de contrefaçon).
- La valeur doit être déterminable : un réviseur agréé atteste la valeur objective, basée sur les prix de marché, les amortissements éventuels, et l’utilité du bien pour la société.
Interventions du réviseur agréé
Un organe de révision indépendant (expert-réviseur agréé ou réviseur agréé, selon la taille du projet) doit :
- Examiner les biens (actifs matériels, immatériels ou titres).
- Contrôler la réalité et la propriété du bien.
- S’assurer de la justesse de l’évaluation : usage de méthodes appropriées (prix de marché, expertises, comparables, etc.).
- Établir un rapport de vérification qui sera joint au dossier de constitution ou d’augmentation de capital.
Cette vérification protège à la fois la société, les créanciers et les actionnaires minoritaires d’une possible manipulation de valeur.
Mention dans les statuts
Les statuts de la société doivent préciser :
- La description succincte de l’apport (type de bien, caractéristiques principales).
- La valeur attribuée et la contrepartie en parts sociales ou actions.
- Le nom de l’apporteur et la date de réalisation de l’apport.
Cette publicité répond à l’exigence de transparence. Lorsque l’apport en nature est prévu dès la fondation, il figure dans l’acte de constitution et sera publié dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC). Les investisseurs et partenaires futurs savent ainsi exactement ce qui compose le capital de l’entreprise.
Distinction entre SARL et SA concernant l’apport en nature
Bien que la Sàrl et la SA permettent toutes deux l’apport en nature, certaines différences existent. Il est essentiel de comprendre ces spécificités avant de choisir la structure juridique adaptée à son projet.
Pour plus d’informations sur les différences entre la SARL et la SA en Suisse, vous pouvez également consulter notre vidéo sur le sujet.
Capital minimal et libération
- SARL : le capital social minimum est de 20’000.- CHF. Les apports en nature peuvent le couvrir totalement, pour autant que la valeur soit validée et que les règles de formalisme soient remplies. Le Code des obligations impose que ce capital soit libéré dans son intégralité dès la constitution.
- SA : le capital-actions minimal s’élève à 100’000.- CHF. Au moins 50 % (soit 50’000.- CHF) doit être libéré dès le départ, mais il est courant de le libérer entièrement pour simplifier. Là aussi, la totalité de l’apport en nature doit être mise à disposition immédiatement.
Publication et documentation
Dans une Sàrl, les apports en nature sont spécifiquement indiqués dans les statuts et annoncés lors de la publication dans la FOSC. Pour la SA, on parle également de “rapport de fondation” si la constitution se fait avec des apports en nature importants, et le réviseur joint son attestation.
Les formes légales demeurent comparables entre SARL et SA, mais la SA soulève souvent plus d’exigences formelles, en particulier si l’on s’attend à ce qu’elle grandisse ou attire des investisseurs externes.
Optiques d’évolution future
Une SARL peut plus aisément recourir à l’apport en nature pour rassembler un matériel ou un outillage spécifique, quand on sait que les associés y sont souvent proches de l’exploitation. En SA, l’apport en nature peut s’avérer stratégique pour lever du capital, notamment si un actionnaire apporte un ensemble d’actifs nécessaires (brevets, fonds de commerce).
La SA jouit d’une image plus “corporate” susceptible d’intéresser d’autres actionnaires, la vigilance concernant la valorisation est d’autant plus cruciale pour éviter les litiges ultérieurs.
Lancez-vous dès maintenant avec notre service de création d’entreprise !
Créez votre entreprise dès 490.- CHF, frais de notaire inclus.
Quelle nature de biens peut-on apporter ?
Les entrepreneurs peuvent apporter une large variété de biens en nature, cependant, seuls les actifs ayant une valeur objectivable et pouvant être transférés immédiatement sont acceptés dans le cadre de cette opération.
1. Biens matériels
- Équipements et machines : ordinateurs, matériel de production, véhicules professionnels, etc.
- Réseaux ou installations : mobilier, stocks de produits, outillage dans le BTP.
- Immobilier : terrain, entrepôt, local commercial, etc.
Exemple concret
Une SARL d’impression 3D voit l’un des cofondateurs apporter plusieurs imprimantes 3D professionnelles, évaluées à 30’000.- CHF par un expert-réviseur. Cet apport couvre la quasi-totalité du capital social requis (20’000.- CHF), tandis que le reste (10’000.- CHF) sert d’apport en espèces pour les besoins de trésorerie.
2. Biens immatériels
- Propriété intellectuelle : brevets, marques, droits d’auteur, logiciels.
- Titres et placements : actions d’autres sociétés, obligations, etc.
Exemple concret
Un ingénieur développe un algorithme sophistiqué pour l’analyse de données financières. Il transfère son algorithme en tant que brevet ou droit d’auteur à la SA qu’il fonde avec des investisseurs, ce qui lui permet de détenir 30 % du capital-actions, évalué à 50’000.- CHF.
3. Créances et droits personnels
Un entrepreneur peut apporter une créance qu’il détient sur un tiers, si celle-ci est jugée solide et réalisable. L’expert-réviseur doit toutefois vérifier la probabilité de recouvrement.
Il est crucial que cette créance soit cessionnée formellement à la société dès sa fondation pour que l’entreprise en devienne propriétaire.
Apport immobilier : focus sur les spécificités
Apporter un bien immobilier au capital d’une société requiert des démarches spécifiques et certaines restrictions, comme les droits de préemption, peuvent s’appliquer.
Évaluation foncière et notaire
Apporter un immeuble en nature implique :
- Une évaluation immobilière minutieuse : le réviseur agréé examine le rapport d’expertise, la valeur vénale, les éventuelles hypothèques.
- Un acte authentique : il faut signer un acte notarié pour transférer la propriété de l’immeuble à la société.
Droits de préemption et consentement conjugal
- Dans certains cantons, la commune peut jouir d’un droit de préemption sur l’achat d’un immeuble, imposant au propriétaire de leur offrir la priorité. L’apporteur doit vérifier si cela s’applique.
- Si le bien est en copropriété ou soumis au régime matrimonial (p. ex. acquêts), il faudra obtenir le consentement du conjoint pour éviter toute contestation ultérieure.
Implications fiscales
Un tel transfert peut engendrer des frais d’enregistrement foncier, des droits de mutation, voire des impôts particuliers si l’opération s’apparente à une cession avec plus-value latente.
Dans certains cas, la loi offre un régime favorable lorsque l’actif est versé à une société détenue principalement par l’apporteur, mais il convient de se renseigner précisément pour éviter les mauvaises surprises.
N’hésitez pas à faire appel aux services d’un expert ou d’une fiduciaire pour vous conseiller, vous accompagner et éviter les erreurs dans vos démarches.
Simplifiez vos démarches et concentrez-vous sur votre activité !
Profitez de nos services complémentaires dédiés aux entreprises.
Les étapes pratiques pour constituer une SARL ou SA avec apport en nature
La constitution d’une société avec un apport en nature suit un processus rigoureux dont chaque étape doit être respectée pour assurer la conformité légale de l’opération
1. Évaluation préparatoire
- Identifier l’actif à apporter (bien matériel, brevet, immobilier…)
- Vérifier qu’il correspond aux conditions (disponible, transférable)
2. Démarche auprès d’un réviseur agréé
- Demander un rapport d’évaluation qui estime la valeur de l’actif.
- Préparer les documents prouvant la propriété : factures, titres de propriété, brevets déposés, etc.
3. Rédaction des statuts
- Inscrire la mention “apport en nature” : description de l’actif, montant en francs suisses, identité de l’apporteur, et parts/actions reçues en contrepartie.
- Pour une SA, établir un rapport de fondation détaillant l’opération.
4. Ouverture du compte de consignation (le cas échéant)
Si l’apport en nature ne couvre pas 100 % du capital, l’apport numéraire restant doit être consigné en banque.
5. Signature de l’acte de constitution
- L’Assemblée constitutive se tient devant le notaire, qui authentifie la création.
- Le réviseur transmet son attestation de vérification jointe au dossier.
6. Transfert effectif du bien
- Pour un immeuble : acte notarié séparé, inscription au registre foncier.
- Pour un brevet ou des titres : formalités de cession (contrat de transfert, modifications dans les registres appropriés).
7. Enregistrement au Registre du Commerce
- Transmission des statuts, du procès-verbal de fondation, du rapport du réviseur.
- Publication dans la FOSC indiquant l’apport en nature.
8. Mise à disposition de l’actif
- La société nouvellement fondée est propriétaire du bien dès l’inscription finale.
- Les associés/actionnaires voient leurs parts sociales ou actions confirmées.
Conseils pratiques et précautions à prendre
- Anticipez les délais : l’évaluation par le réviseur, la rédaction des documents et l’acte notarié peuvent prendre plusieurs semaines, surtout si l’actif est complexe.
- Évitez la surévaluation : un gonflement artificiel du capital peut entraîner des litiges avec d’autres associés ou poser problème si la société tombe en surendettement.
- Conservez une trace de la propriété : pour des droits immatériels, conservez brevet, certificat de marque, ou tout document prouvant votre possession légitime.
- Méfiez-vous des droits d’usage limités : un bien dont vous n’avez qu’une jouissance partielle ou à durée déterminée n’est pas un apport en nature valable, car la société doit en disposer à son gré.
- Consultez un expert fiscal : les conséquences d’un apport en nature peuvent varier selon votre canton et la nature de l’actif (plus-value éventuelle, droits de mutation immobiliers, etc.).
- Communiquez en toute transparence : si vous constituez la société à plusieurs, il est essentiel d’impliquer tout le monde dans la validation de la valeur attribuée. L’objectif est d’éviter toute contestation future sur la quote-part de capital que cet apport représente.
Conclusion
L’apport en nature représente une option précieuse pour les entrepreneurs suisses désireux de créer une SARL ou une SA sans nécessairement mobiliser des liquidités importantes.
Avant de se lancer, il reste primordial d’obtenir un accompagnement adéquat (fiduciaire, réviseur, notaire, avocat) et de procéder à une planification minutieuse.
Le jeu en vaut la chandelle, puisque cette forme de financement contribue à l’indépendance financière de la société et confère à l’entrepreneur un capital action ou un capital social correspondant réellement à la valeur de son patrimoine.
Sur le même sujet
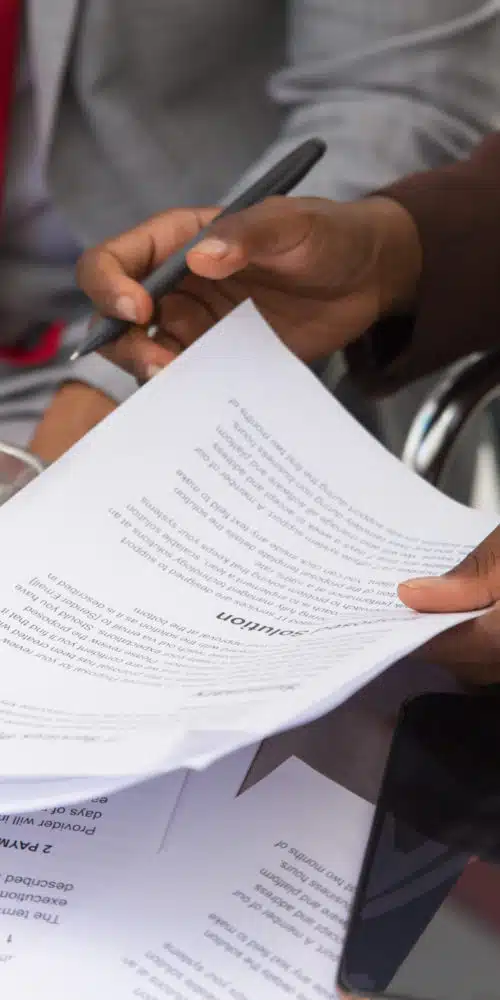
Modèle de statuts pour une SARL en Suisse – Entreprendre.ch

Domicilier le siège son entreprise en Suisse ? Quel canton choisir ?

Fermer ou liquider sa société en Suisse : quelles sont les étapes ?

Droits de signature en Suisse : Comment s’y prendre ?

Arnaque à l’annuaire en Suisse : Comment l’éviter ?

Ouvrir un compte de consignation du capital pour une Sàrl ou SA

Transformer une Raison individuelle (RI) en SARL

SARL ou SA : Quelle est la meilleure option pour votre entreprise ?

La raison individuelle en Suisse

Légalisation de signatures et création d’entreprises – Explications

Les organismes à connaître quand on se lance en tant qu’entrepreneur en Suisse
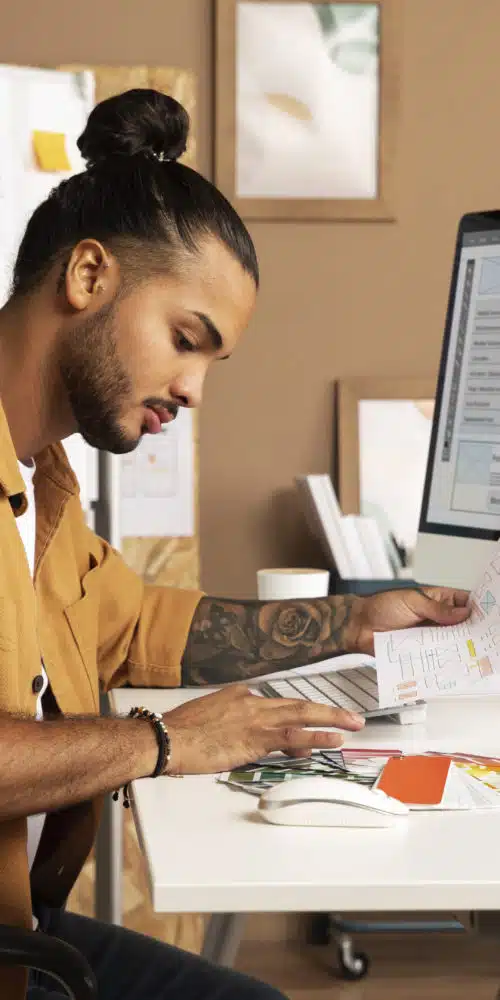
Créer une SARL seul – Les conseils d’Entreprendre.ch
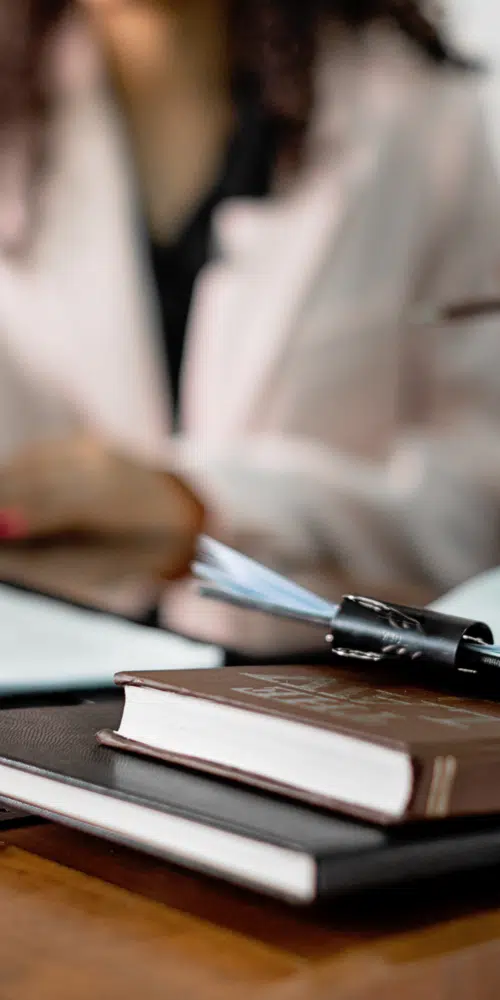
Les procédures administratives pour la création d’une entreprise

Pourquoi la SARL est la meilleure structure pour entreprendre en Suisse ?

Être salarié et entrepreneur : comment s’y prendre
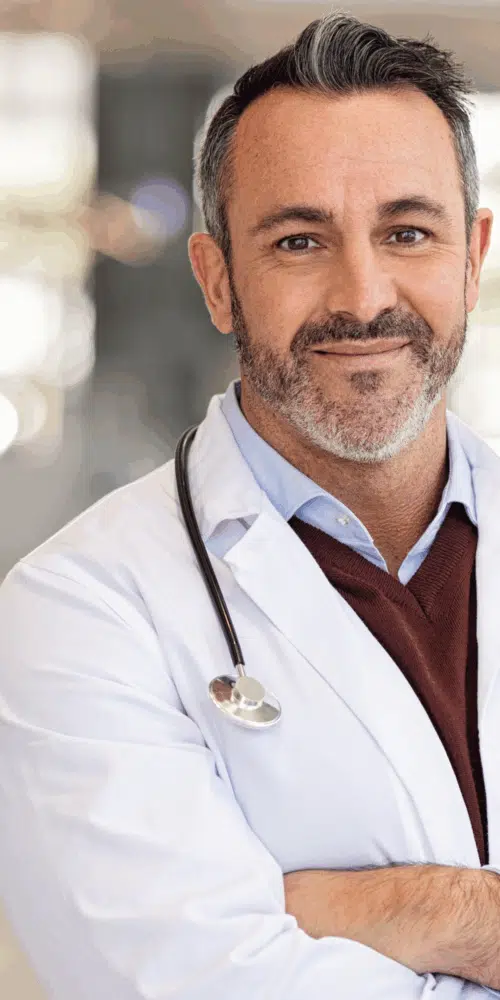
Ouvrir son cabinet de médecin en Suisse
Qu’est-ce qu’un apport en nature et quels biens peuvent être apportés pour créer une SARL ou une SA en Suisse ?
Un apport en nature désigne tout bien autre que de l’argent qu’un fondateur peut apporter lors de la création d’une société. Il peut s’agir de matériel, machines, brevets, titres, créances ou même d’un bien immobilier. L’actif doit être transférable, disponible immédiatement et avoir une valeur économique objectivable.
Comment est évaluée la valeur d’un apport en nature en Suisse ?
L’évaluation d’un apport en nature doit être effectuée par un réviseur agréé. Il analyse la valeur du bien sur la base des prix de marché, de l’utilité pour l’entreprise et des amortissements éventuels. Cette vérification garantit une valorisation correcte et protège les fondateurs et créanciers.
Quelles sont les formalités légales pour réaliser un apport en nature ?
L’apport en nature doit être mentionné dans les statuts de la société et validé par un rapport d’un réviseur agréé. Un acte notarié est requis pour la constitution de la société et le transfert de propriété des biens concernés. Enfin, la transaction est enregistrée au registre du commerce et publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC).
Quels sont les avantages et les risques d’un apport en nature pour un entrepreneur ?
L’apport en nature permet d’éviter de mobiliser des liquidités et de valoriser des actifs existants sans les vendre. Il peut aussi renforcer le bilan de la société. Cependant, il impose des formalités strictes, un contrôle rigoureux de la valeur des biens et un transfert définitif de propriété, ce qui signifie que l’apporteur perd tout droit sur l’actif transféré.
Que devient le capital social une fois la société créée ?
Le capital devient un actif de l’entreprise et peut être utilisé pour financer ses premières dépenses (achat de matériel, salaires, marketing…). Cependant, il ne peut pas être retiré librement par les fondateurs à des fins personnelles.